tahar bekri
À LA RECHERCHE DE SELMA

Ferran Cremades i Arlandis
TAHAR BEKRI: À LA RECHERCHE DE SELMA
LA RENCONTRE
Un matin d’avril, la sonnette retentit et le facteur, avec son sourire cordial habituel, me mit un télégramme entre les mains. Pendant un certain temps, je l’ai gardé dans ma main sans me décider à l’ouvrir et je me suis amusé en m’interrogeant sur l’identité de l’expéditeur. Je l’ai d’abord lu d’un geste tiraillé entre curiosité et suspicion, comme si j’avais peur que quelqu’un se mêlât de ma vie privée. Puis, sans lever la tête, je l’ai relu avec des yeux étonnés. Le département d’espagnol de l’Université d’Oran m’a transmis une invitation pour participer à un colloque international dont le thème central était l’Exil et la Méditerranée. La date était fixée pour la fin d’avril. Tout de suite, je sortis envoyer un télégramme et donner ma réponse positive. De cette façon j’ai réussi ainsi à m’éloigner d’Hôtel Africa, le roman que je venais de publier.
A mon arrivée à Oran il m’est arrivé quelque chose qui m’a plongé dans une chimère d’absurde toute la nuit. Personne n’était venu me chercher à l’aéroport pour me conduire au lieu d’hébergement prévu par les organisateurs. Comme je ne connaissais pas Oran, j’ai demandé au chauffeur de taxi de m’emmener dans un hôtel au centre-ville. Il m’a laissé au Continental où Albert Camus avait vécu un moment par le passé. Il y avait encore une odeur grossière de colonialisme et l’air qu’on y respirait était malsain. Quand tu montais dans l’ascenseur, le temps semblait te submerger.
Le lendemain, le réceptionniste apprit par la presse que ce même matin a eu lieu dans la grande salle de l’université l’inauguration d’un colloque d’écrivains, de critiques et de professeurs de tous les coins de la Méditerranée. Il a appelé un numéro de téléphone et a découvert que la plupart des participants à la Rencontre séjournaient dans le quartier résidentiel de la plage d’Al Ándalus. Puis il est sorti dans la rue et a appelé un taxi.
J’ai eu juste le temps de laisser ma valise dans la chambre qu’ils m’avaient réservée, ils ont immédiatement appelé tout le monde à partir dans le bus vers l’université. Je n’ai même pas pu prendre mon petit déjeuner.
Je ne le connaissais pas du tout. Je ne l’avais jamais vu nulle part dans le monde, mais le jour de l’ouverture du colloque parmi tant d’historiens et d’écrivains qui y assistaient, il était le seul assis à côté de moi. Ou peut-être était-ce moi qui avais choisi cette chaise simplement parce qu’elle était libre.
Je savais qu’il s’appelait Tahar Bekri parce que j’avais lu son nom sur la carte de participant au colloque que l’organisation nous avait donnée à l’entrée et que nous devions porter sur le revers de nos vêtements.
L’un des organisateurs du colloque parla de la nécessité de raviver le rêve de la Méditerranée et dit son souhait d’une rencontre libre et fructueuse entre l’Orient et l’Occident. Tout se passait en parfaite harmonie mais une fois l’accueil et les présentations faites, l’un des assistants prit la parole et se mit à parler en français en évoquant la figure d’Albert Camus, en revendiquant, au nom de la dignité de la personne humaine, les droits d’une religion fraternelle, au-delà du christianisme, de l’islam et du marxisme, un feu croisé éclata entre arabophones et francophones. Les voix sont devenues des grognements et même des gestes menaçants. Bien sûr, au-delà des langues, il y avait des raisons politiques et Tahar Bekri a demandé à intervenir pour servir d’interprète à cause du blocage qui s’est développé dans la grande salle parmi les participants. Il a profité de l’occasion pour parler du dialogue entre les langues et les cultures. Sans aucune gêne, il a exprimé ses liens profonds à la fois avec le bilinguisme et la diversité culturelle.
De nombreux historiens et écrivains méditerranéens, notamment des poètes, avaient été invités avec la volonté expresse de renouer un dialogue fondé sur la confiance et le respect mutuel. Il y avait des Grecs et des Libyens, des Italiens et des Tunisiens, des Albanais et des Turcs, des Palestiniens et des Français, des Libanais et des Chypriotes, des maltais et même de la Cappadoce. Et bien sûr des espagnols. Selon les organisateurs, il n’y avait personne pour représenter Israël, qui avait également été invité. Il y avait l’Égyptienne Nawal El Saadawi, habituée à évoluer dans les geôles sombres de la bureaucratie gouvernementale avant de se retrouver la cible des intégristes. Il y avait les Algériens Kateb Yacine et Tahar Djaout. Je ne sais pas pourquoi Mahmoud Darwich n’a pu quitter la Palestine, puisqu’il était également invité au colloque.
Le lendemain, la presse algérienne a couvert l’événement et a publié une photo sur laquelle Tahar Bekri et moi figurions au premier plan, car nous étions à la première rangée dans la salle. Tous les autres étaient dans un arrière-plan si sombre qu’on pouvait à peine reconnaître leurs visages, sans doute parce que le photographe avait trop ouvert l’œil de la caméra.
À la fin des premières présentations, nous nous sommes salués de manière cordiale et avec effusion, peut-être à cause de la photographie.
− Je m’appelle Tahar Bekri.
Le poète s’est présenté en toute cordialité et montra un intérêt particulier afin de connaître mon identité.
Quelques moineaux nous tinrent un moment compagnie jusqu’à ce que nous décidions d’aller à la cafétéria que nous découvrîmes dans un coin. Tahar Bekri était accompagné d’autres poètes arabes.
− D’où venez-vous?
Ai-je demandé après avoir commandé mon thé vert. Et il m’a répondu sans hésiter après avoir demandé un long café.
− De la Tunisie. Je suis le septième enfant parmi dix frères et sœurs. On s’habitue à la douleur, à vivre avec l’image de la mère mourante.
Il essaya d’atténuer par ses mots la douleur de l’absence. Pendant un temps, il évoqua des événements familiaux, des jeux et des souvenirs d’enfance. Il me parla de la maison du barbier, des corbeilles de figues noires, des colonnes romaines, des tablettes coraniques.
Quand je lui ai dit que je venais d’Espagne, il a pris une gorgée de café et a immédiatement laissé la tasse encore fumante sur le comptoir du bar.
− Oh, mon Dieu, l’Espagne ! Pour moi c’est un lieu mythique, un lieu chargé d’histoire.
Les yeux pétillants reflétaient à la fois l’émerveillement et la curiosité.
Les événements politiques qui ont secoué la Tunisie dans les années 1970 l’avaient contraint à suivre le même itinéraire que celui de nombreux poètes à travers l’histoire de la littérature.
− L’itinéraire de l’exil. Quand j’étais étudiant à l’université, j’ai été arrêté pour mon appartenance à un syndicat étudiant très actif et critique du régime d’Habib Bourguiba. Après avoir connu le sort des détenus de la prison de Borj Erroumi, dans le nord de la Tunisie, j’ai été libéré en perdant mes droits civiques. Depuis 1976 je vis en exil en France. Il m’avoua tout cela avec un regard véhément qui reflétait le désir irrévocable de rester en vie. Maintenant, il enseigne aux Universités de Paris X et de Paris III et il est, en même temps, un grand animateur de manifestations artistiques et culturelles.
Tahar Bekri a terminé sa tasse de café jusqu’à la dernière goutte. Son regard était pénétrant comme celui d’un plongeur qui plonge dans la mer pour atteindre la perle.
− Je n’aime pas être en retard.
Il ajouta que son nom était sur la prochaine table ronde.

Tahar Bekri parlait de poésie et d’exil en prenant pour point de départ le poète préislamique Umru’ul Qays, auquel il avait rendu hommage dans un recueil, Le chant du Roi errant. Il a été appelé ainsi parce qu’il avait perdu son père dans cette Arabie, victime de luttes tribales et fratricides. Puis il nous surprit par le récit d’une expérience personnelle, qu’il raconta publiquement, et qu’il avait développée dans un livre qu’il était en train d’écrire : Poèmes à Selma.
De retour dans la rue, il plissa de nouveau les yeux comme si la lumière du soleil le gênait. Il cherchait toujours un peu d’ombre.
− Il fait chaud. Mucho calor.
Il me dit cela en déboutonnant sa veste bleu marine. Calor était l’un des rares mots qu’il savait dire en espagnol.
− A mon arrivée à Collioure, l’été 1985, une sensation mélancolique obscurcit mes yeux et emplit mon être, excité que j’étais à l’idée de redécouvrir la Méditerranée que j’avais abandonnée après un exil forcé. En imaginant mon pays natal de l’autre côté de la mer, une sensation de bonheur violent m’envahit.
Il me raconta également sa visite au petit cimetière où se trouvait la tombe du poète Antonio Machado.
Nous nous sommes revus dans l’après-midi lorsque nous avons pris le bus pour retourner au complexe résidentiel où nous logions. Nous nous sommes assis l’un à côté de l’autre. À un moment du voyage, il a ouvert une petite mallette noire quelques instants et chercha quelque chose jusqu’à ce qu’il sorte un livre de poèmes, qu’il m’a offert en signe d’amitié. Tahar Bekri définit le poète comme un être en mouvement constant vers une identité brisée. Au fond, ses poèmes sont un mur contre la mort, un port qui fait face au naufrage.
Avant de m’endormir, j’ai ouvert au milieu le livre «Le laboureur du Soleil». C’est une habitude que j’ai avec les livres de poésie. Le poème s’intitulait « Quatre saisons pour un arbre disparu ». Et quelle ne fut ma grande surprise quand j’ai lu le fragment suivant :
Saison I :
La terre qui ouvre ses bras, ton tronc
qui s’affole et l’horizon des yeux meurtris
se souviennent de la palmeraire que tu fus…
Quand j’ai fini de lire tout le poème, un frisson parcourut mon corps. Il était dédié à Sálah K. Sálah K. m’est apparu à Oran, dans un livre de poèmes, partout dans le monde, impossible de l’oublier. Je n’ai pas pu dormir cette nuit-là. Il me semblait que Sálah K. était devenu une voix qui présidait à tous les mouvements de mon esprit, une voix qui était parfois un silence et d’autres, un cri qui m’étouffait. Une voix qui exprimait un message conçu depuis l’origine de l’histoire. J’étais lié à cette voix comme le peintre est attaché aux couleurs. Une voix qui m’a fait totalement oublier ma thèse de Doctorat que je devais préparer sur les Morisques et qui m’a ordonné de voyager pour rencontrer Sálah K. Comme si j’allais retrouver une partie de ma vie dans cette rencontre. Une voix qui me disait que je n’étais que l’instrument d’une force beaucoup plus puissante qui maintenant me poussait à retourner sans délai en Tunisie.
LA DÉCOUVERTE
Le lendemain, à l’heure du petit-déjeuner, sans me raser ni essuyer mon visage, j’ai retrouvé la table de Tahar Bekri et je me suis assis à côté de lui. Après m’avoir souhaité un bonjour fraternel ! Il surmonta la timidité de son regard et traça de sa main ouverte le geste de l’hôte qui incite l’invité à goûter aux plaisirs de la table. Il le fit avec le même esprit que quelqu’un invite un ami qui revient après une longue absence.
− La confiture de coing est délicieuse. Le beurre n’est pas mal.
Il m’a immédiatement servi un café au lait. Il avait du mal à garder le sourire.
Tahar Bekri avait suivi les cours de traduction arabe de Salah K. Il ne trouvait pas assez des mots pour faire l’éloge de son professeur. C’était un homme merveilleux et amoureux de l’étymologie. Il passait des heures à essayer de trouver l’origine d’un mot ou d’un sens ancien. Un véritable voyage dans l’univers des mots et le mystère de leur origine. Grâce à Salah K. et sa formidable traduction en arabe du roman « Je t’offrirai une gazelle », Tahar avait pu consacrer sa thèse de doctorat à l’écrivain algérien francophone Malek Haddad.
Sans aucun doute, Salah K. avait été abattu comme un arbre, d’un coup de hache, comme si le calife du destin avait ordonné sa décapitation. Mais les arbres, après des gelées mortelles, peuvent aussi repousser encore et encore.
L’arrivée du bus qui nous emmenait à l’université interrompit notre agréable conversation.
L’après-midi, une fois les présentations finies, Tahar Bekri m’a proposé de faire un tour dans la ville et j’ai été ravi d’accepter. Le soleil froid traînait ses souliers d’ombre.
− J’ai l’impression d’être dans une ville que j’ai déjà vue. Oran me rappelle la Tunisie.
Bientôt nous sommes entrés dans une spirale de rues en zigzag. Oran sentait les épices. Je pouvais distinguer l’odeur de la cardamome et celle du cumin. Un gris cendré couvrait les bâtiments et l’air était empli d’une odeur d’oranges amères. Après avoir fui des impasses sombres, nous sommes arrivés sur une place. Bientôt nous passâmes ensuite devant le regard immobile et complice des lions de la mairie et Tahar Bekri se retourna pour contempler la silhouette de la montagne de Santa Cruz.
J’ai été surpris par l’absence de touristes et de voyageurs dans les rues. Je lui en ai fait part. Une meute de chiens sales et affamés nous a entourés jusqu’à ce que nous ayons réussi à atteindre le front de mer. Nous trouvâmes bientôt un banc vide et nous nous assîmes comme deux voyageurs errants. C’était étrange. On ne voyait pas d’amoureux, ni des mains entrelacées comme dans n’importe quel port méditerranéen. Tahar Bekri n’a cessé de me raconter des souvenirs et des expériences inoubliables de son enfance.
Beaucoup de choses que je ne comprenais pas bien sûr, comme l’attitude de certains intellectuels maghrébins envers le pouvoir que Tahar Bekri m’expliqua. Dans ce monde personne ne peut vivre enfermé dans sa tour d’ivoire, argumenta-t-il et il se tut car il avait la gorge nouée.
Lorsque j’ai exprimé mon étonnement face à la recherche de Selma, Tahar Bekri m’a surpris avec le récit de son voyage. Pendant un instant ses yeux me semblaient ceux d’un hypnotiseur. L’histoire avait un point de départ.
− Dans le port de Skagen, au Danemark, j’ai découvert un bateau de pêche portant le nom de Selma. Peu à peu, sans m’en rendre compte, ce nom lia mon être au passé le plus lointain et en même temps au présent le plus inquiet. Cet ancien nom arabe m’a possédé comme une obsession. Puis vint un voyage vers le nord. Un voyage en Scandinavie.
Rapidement, il me rappela la phrase de l’écrivain soudanais Taïeb Saleh : « Je suis un sud qui a la nostalgie du nord ». Le Nord et le Sud s’embrassaient, entremêlés et fusionnés dans son souvenir. Sa voix donnait de la densité à la pensée. L’aisance avec laquelle il parlait, jointe aux gestes timides de ses mains, donnait à sa silhouette une sorte de dignité diplomatique.
Le bruit infernal d’une voiture avec ses brusques accélérations et freinages brisait le silence du crépuscule. Non loin de là, nous rencontrâmes un groupe d’hommes en discussion animée devant un restaurant d’où émanait une odeur âcre de friture.
J’osais à peine l’interrompre. Parfois, je le faisais en profitant du fait qu’il a mis la pipe dans la bouche. Ému par cette histoire, je l’ai interrogé sur différents sujets.
−Ce nom ne m’a pas laissé tranquille. Il était impossible de le chasser de mon esprit. Une marée d’images, de métaphores et de sensations a commencé à se mêler aux souvenirs. C’était comme un rêve dont je ne pouvais pas me débarrasser.
Cela argumenté devant mon regard d’expectative. Il me fit part de son émerveillement face aux paysages enneigés du nord, ce fut l’une des rares fois où je l’ai vu sourire de bon cœur. Il parla de cette histoire avec le même air d’intrigue avec lequel un détective décrit un événement tragique, mais en même temps avec le même air abstrait qu’un compositeur utilise pour parler de sa musique.
En suivant le fil de ses arguments, j’ai comparé la musique de Selma avec celle de Sálah K.
− C’est la musique de la mer battant contre les falaises.
Pour la première fois, j’ai senti le froid envahir mon corps. Le récit de son expérience personnelle m’a beaucoup retenu car il m’est arrivé la même chose avec le nom de Salah K.
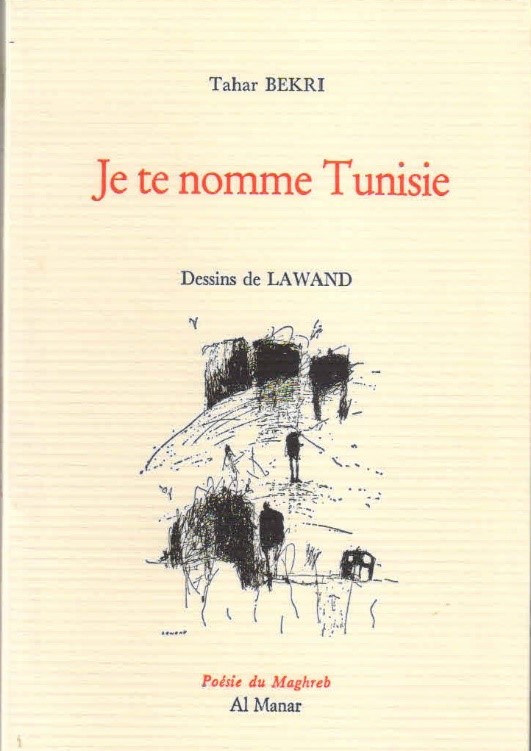
Tahar Bekri hocha la tête.
− Le nom de Selma m’obséda, bientôt, tout s’est précipité dans mon esprit, les souvenirs, l’exil, l’absence et la plaie ouverte. Mais il y avait aussi la joie du voyage, l’intensité des émotions, le mouvement tumultueux du monde politique, le bonheur de découvrir de nouveaux pays. Puis il y a eu d’autres voyages. Et bien sûr, je ne pourrai jamais oublier l’accueil et l’hospitalité de mes hôtes scandinaves. Leurs bras ouverts m’ont donné une paix qui a guéri même mes blessures les plus profondes. Je me souviens que sur l’autoroute entre la Suède et la Norvège, j’ai vu un panneau indiquant le nom de Selma Lagerlöf, la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature, en 1909. Arrivé à Oslo, je n’ai pas pu me retenir plus longtemps et j’ai ouvert l’annuaire téléphonique. La surprise était énorme. Ma curiosité n’a pas été déçue. Le nom de Selma figurait sur plusieurs pages à différents endroits en Norvège. Elle est aussi commune au nord qu’au sud. C’est comme une lumière qui nous ouvre l’horizon. Il est impossible de réduire la surface de la terre à une seule ville ou à un seul pays.
Encore une fois, le nom de Selma a navigué et voyagé à travers le monde, se déplaçant du sud au nord et vice versa. Je n’ai pas hésité à décrire cette histoire comme quelque chose d’obsédant et d’incompréhensible, comme la manifestation d’un esprit agité. Tahar s’étonna de ma considération et sourit avec une certaine ironie.
− La vie est faite de la même argile que Selma.
Pendant un moment nous restons silencieux et écoutons le bruit des vagues. Le crépuscule tombait lentement. Les violettes du couchant avaient déjà commencé à teindre les toits d’Oran.
− Pourquoi le nom de Selma vous obsède-t-il autant ? Peut-être avons-nous hérité d’une mémoire historique grâce à la génétique ?
Je montrais un vif intérêt à connaître son avis sur ce sujet. On se connaissait depuis trois jours et ont parlait déjà comme deux vieux amis.
− Le pensez-vous vraiment aussi ? Plusieurs fois j’ai pensé à faire un portrait d’elle. Peut-être pourrait-elle avoir un visage oriental, un corps grec et un esprit occidental. Il est difficile de décrire le cœur d’une personne. Mais avec le temps j’ai refusé de définir les traits d’une femme qui existe à la fois au Nord et au Sud, à l’Est et à l’Ouest. Il est difficile de peindre les vérités intangibles, les énigmes.
Parfois, il arrêtait son histoire et plissait les yeux pour que le flot de ses mots puisse couler plus librement.
− Selma ne connaît pas le vertige des mutations.
Je l’ai écouté avec une satisfaction complice car je me sentais impliqué dans son histoire comme si elle faisait aussi partie de l’histoire de Sálah K.
− Parfois, j’ai l’impression que plus je voyage à la recherche de Selma, plus je m’éloigne d’elle.
Dans sa recherche ininterrompue, Tahar Bekri avait traversé des époques, des frontières et des continents.
− On s’aperçoit enfin qu’on trouve l’éternité dans quelque chose d’aussi éphémère qu’un nom de femme. Ce nom resurgit du fond de la mer et m’entraîna dans un abîme. Je me suis senti appelé. C’était quelque chose qui avait un rapport avec ma vie.
Avec ces aveux, nous sommes tous les deux devenus complices du destin. A la tombée de la nuit, nous avons été surpris par le vol fou de quelques hirondelles au-dessus des vagues plombées de la mer et Tahar Bekri proposa de prendre un taxi pour se rendre à la plage d’Al Ándalus. Comme deux fugitifs, nous avons fui le front de mer. Une fois de plus, il se présente comme un voyageur infatigable.
Tahar Bekri maîtrisait parfaitement la langue de Molière.
− La terre tourne sur elle-même et moi aussi. Ma vie est une errance continue comme un derviche. La terre n’a pas de frontières et moi non plus. L’identité de chacun n’est jamais quelque chose de fermé ou de définitif, mais elle prend forme au fil de ses expériences, de ses rencontres avec l’autre. Si vous voulez tout savoir sur la mystérieuse disparition de Sálah K., vous n’aurez d’autre solution que de retourner en Tunisie. Beaucoup de ceux qui l’ont connu et aimé sont encore en vie.
Avec une certaine inquiétude, il m’encouragea à retourner en Tunisie au plus vite afin de découvrir la véritable personnalité de Sálah K.
LA DÉCHIRURE
Après le virage, j’ai vu un panneau sur la droite annonçant la proximité de la plage de la Corniche. On pouvait voir un sable blanchâtre qui faisait ressortir encore plus le bleu foncé de la mer. A peine une feuille bougeait dans les oliviers qui à cette heure de la nuit étaient couverts de cendre. Le vol d’un merle solitaire traversant la route nous a surpris tous les deux. Le taxi a continué à longer toute la ligne sinueuse de la côte où l’on pouvait voir quelques murs démolis de maisons abandonnées qui étaient autrefois des résidences.
Tahar ouvrit la fenêtre et dirigea son regard scrutateur vers le calme suspect de la mer.
− C’est étrange. Voir une plage déserte en Méditerranée produit une mélancolie particulière, comme si cette région ne pouvait profiter que de la saison estivale.
Puis il m’a expliqué que près de là se trouvait la villa où Albert Camus a écrit La Peste.
Ce soir-là, c’était le dîner d’adieu de la Rencontre des écrivains et les tables débordaient de pains, de plateaux de salades, de crevettes et de langoustes. Les bouteilles de vin rosé ressemblaient à des vases remplis de bouquets de coquelicots.
Heureusement, on a trouvé deux chaises vides à côté des amis de Tahar Bekri. Il y avait le poète et écrivain turc Ozdemir Ince, le romancier grec Vassilis Alexakis et le poète et journaliste algérien Tahar Djaout. Avant de nous asseoir, on a salué un groupe d’étudiants algériens.
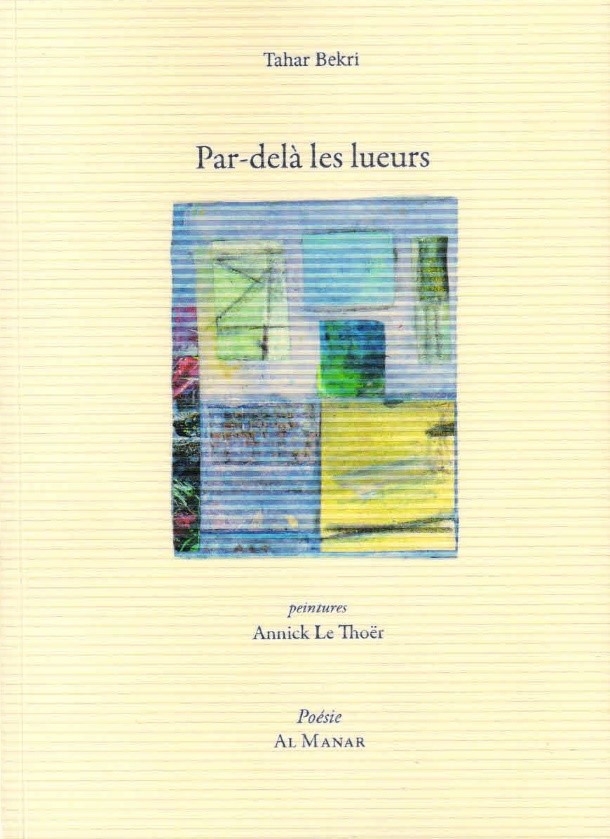
Tahar Bekri a commencé à parler d’Al Ándalus parce qu’on était sur une plage qui portait ce nom.
− Le savez-vous, ami K. ? Bien qu’il s’agisse d’un terme d’origine vandale, Al Ándalus est très vite devenu synonyme pour les Arabes, encore aujourd’hui, d’une vie agréable dans une nature généreuse. Le mot Al Ándalus est lié à une époque de splendeur, d’opulence et de vie merveilleuse, à un tel point qu’il est difficile de convaincre un Arabe actuel que le mot n’est pas d’origine arabe. Aujourd’hui encore, Al Ándalus est vécu dans l’imaginaire arabe comme le paradis perdu.
Tahar Djaout, qui jusque-là était resté silencieux, écoutant les propos de ses collègues, voulut intervenir. Diplômé en mathématiques, c’est l’amour de la littérature qui l’a amené à faire du journalisme.
Certains des écrivains appartenant à l’école dite d’Alger ont tenté de perpétuer l’image d’un paradis perdu dans une perspective nationaliste.
Puis il se souvint d’une légende qui faisait partie de l’histoire.
− Certaines familles de Tlemcen, d’origine de Grenade, ont gardé la clé de la maison abandonnée à ce jour et ont caressé le rêve de revenir pendant des générations.
- Mais ces clés ne servent plus à ouvrir les portes.
L’un des journalistes algériens qui nous accompagnait rejetait toute tentative de récupération nostalgique qui annonçait une sorte de retour à un âge d’or faussement idéalisé.
− Al Ándalus entraîne à la fois les ruines amoncelées et l’espoir persévérant. Le rêve de la Méditerranée est fait de cette argile.
Tahar Djaout était complaisant avec son verre de vin à la main. Il l’a pris gorgée par gorgée comme quelqu’un qui prenait des remèdes. L’arc de sa moustache lui fit un sourire complice qui invitait à l’hospitalité et qui se répandit parmi les personnes présentes, peut-être sous l’effet de ce vin couleur coquelicot.
Au dîner, il y a eu aussi quelques remarques subtiles et brèves sur la situation actuelle du monde arabe, mais surtout, des regards d’appréhension et des silences suspects.
Les poètes aiment à la fois l’histoire et les plaisirs de la table. Les anecdotes et les histoires coulaient comme du vin et les visages des poètes s’illuminaient en évoquant le rêve du paradis. C’était étrange et en même temps excitant d’entendre les différents accents d’une même langue.
− On écrit ce que dictent nos entrailles et non ce que veulent entendre les puissants ou les fanatiques.
Dans un geste qui semblait incontrôlable, Tahar Djaout a essuyé ses lunettes comme si elles étaient embuées.
Les visages des poètes rayonnaient de sourires complices. Le romancier grec Vassilis Alexakis est intervenu, portant un toast à l’abolition des murs qui séparent la Méditerranée. Il n’y avait pas de frontière entre Ankara, Tunis, Paris et Alicante.
− Allant d’un endroit à l’autre, d’un pays à l’autre, de soi-même à l’autre, parfois je pense trouver l’équilibre parfait, mais d’autres fois j’ai l’impression de tomber d’une falaise dans un vide absolu, de n’avoir d’autre patrie que la page vierge.
Après le dîner, les poètes se sont préparé à réaliser la séance de lecture de poésie annoncée dans le programme comme point culminant du colloque.
Tahar Djaout a été le premier à se présenter. De son regard serein, il dominait la force du langage et du public. Après avoir vidé le verre de vin, il récita un poème qu’il avait intitulé Mon Amoureuse :
… toi perdue,
je tiendrai dans mes bras
que ce tas de sable qui coule,
avec la mort embusquée dans le dernier grain.
Derrière les fenêtres, la mer s’était figée dans un tableau abstrait. Tahar Bekri a parlé d’Ali Al Hoçri, poète et érudit aveugle de naissance, contraint de quitter Kairouan lorsque les tribus arabes nomades des Beni Hilal, arrivées comme des essaims de sauterelles de la Haute-Égypte, pillèrent et envahirent la Tunisie vers 1048. Ayant perdu Tout espoir de retour, le poète aveugle avait écrit une élégie aussi belle que déchirante où il pleure son pays natal. D’une voix grave, Tahar Bekri se mit à réciter une partie du poème :
Même si vous êtes loin et que la mer nous sépare
Nos âmes se visitent dans le sommeil
Je n’ai pu dormir si ce n’est votre image
Comment l’exilé peut-il trouver sommeil
Bientôt des poètes se précipitèrent prêts à voler à la mer les secrets qu’elle gardait dans ses flots incessants. La lumière de la pleine lune accentuait la couleur des visages et faisait briller les verres à vin qui commençaient déjà à fermer les yeux. Cette plage abandonnée est devenue le paradis terrestre. Les poètes ont profité de l’occasion pour s’investir en souverains d’un empire appelé exil où l’on se sent seigneur de toutes les patries.
− Les nuits comme celle-ci, je rêve des palmeraies du sud tunisien.
Tahar Bekri était mélancolique et croisait les mains sur les revers de sa veste bleue, couvrant sa gorge car il avait peur de l’humidité qui venait de la mer. De ses yeux un peu noctambules, il scrutait l’infini.
Les mêmes étoiles qui brillaient dans le ciel brillaient aussi dans la mer. Les mots jaillirent comme des échos lointains et devinrent des vagues. Je vis leurs regards suspendus d’étonnement. La pleine lune avait teint la mer d’écume écarlate. Au milieu du silence, j’ai perçu que tout ce que je vivais n’était pas réel mais faisait partie de l’illusion d’un rêve. J’ai boutonné ma chemise et j’ai mis l’écharpe autour de mon cou.
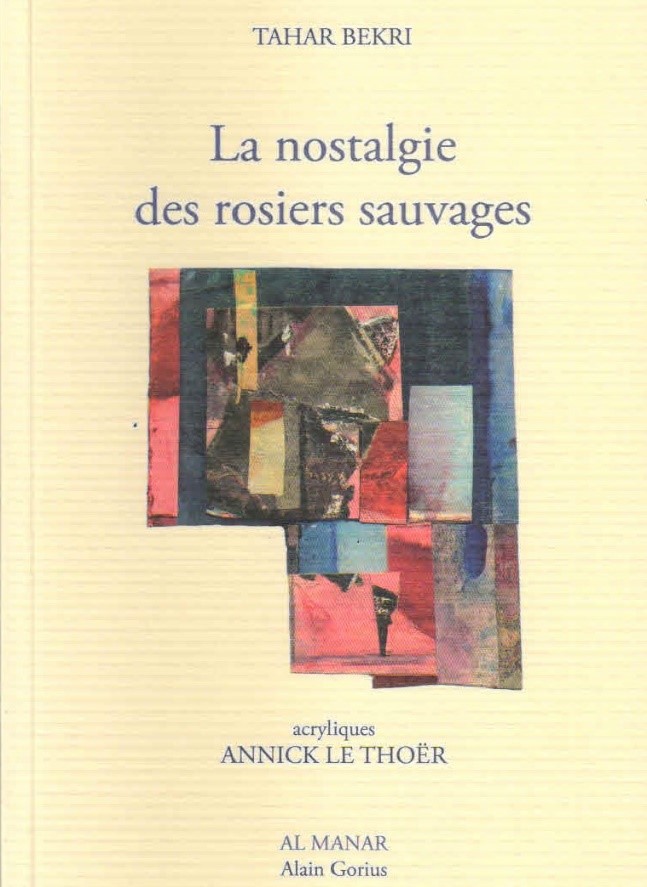
Le bruit des vagues m’a possédé toute la nuit. Je pouvais à peine m’endormir.
Le lendemain, les toasts continus se sont transformés en maux de tête et malaise. À la fin, j’ai attrapé un gros rhume. Quand j’ai toussé, j’ai remarqué que même mes bronches me faisaient mal et j’ai eu recours au café et aux médicaments pour savoir avec certitude à quelle heure de la journée mon vol partait.
Avant de me dire au revoir à l’aéroport d’Oran, Tahar Bekri m’a avoué qu’au fil de nos rencontres il avait pu vérifier que j’avais des gestes similaires à ceux de Sálah K. Il l’avait remarqué lors de mon exposé. C’est ce qu’il m’a dit. Et pas seulement dans la façon dont je regardais les gens mais aussi dans la façon dont je prononçais la lettre S. Je n’en revenais pas.
Puis il promit de m’envoyer par la poste, et traduit en français, la dédicace que Sálah K. avait écrite dans la traduction arabe de l’ouvrage de Malek Haddad. Je l’ai considéré comme un document qui pouvait m’intéresser et dont la lecture pourrait m’apporter de nouvelles informations sur la vie de Sálah K. Dans mon esprit, j’ai commencé à sentir la naissance d’un nouveau roman.
Tahar Bekri m’a fait un câlin amical à l’heure de la séparation.
Et c’est alors qu’il a prononcé mon nom de famille avec la même intensité avec laquelle le commissaire avait prononcé celui de Salah. Avec une K guttural et emphatique qui venait de l’intérieur de la gorge.
− Nous avons choisi une voie difficile d’accès et une voie au bénéfice du doute à court terme. Tu pars à la recherche de Salah K. et je pars à la recherche de Selma. Le voyage est long et nous avons encore de nombreux ports et aéroports à franchir et de nombreux horizons à découvrir.
Ses yeux de noctambule s’étonnaient de l’imminence du départ.
Oran disparut aussitôt derrière les ailes de l’avion comme s’il n’avait jamais existé. Peut-être que les discussions animées entre arabophones et francophones étaient-elles un signe de la transe funèbre que le temps nous apportera plus tard. Rien ne laissait présager que derrière le silence de plomb qui régnait sur les plages abandonnées et derrière les regards gris qui exhalaient l’odeur d’oranges amère, couvait le feu d’un volcan qui allait bientôt entrer en éruption.
La mèche était déjà allumée et en trois ans le jardin de l’Algérie se transforma en une grotte primitive et un terrier ténébreux. Aucun des participants à ce colloque sur l’exil et la Méditerranée n’aurait pu imaginer la fin tragique qui attendait Tahar Djaout.
Sept ans plus tard, le 26 mai, après avoir pris le volant de sa voiture, s’apprêtant à démarrer, le poète et journaliste sera froidement assassiné par un adolescent mendiant, vendeur des cigarettes et d’allumettes. Le garçon, après lui avoir demandé de bien vouloir baisser la vitre de la voiture, lui tira une balle dans la tête, à bout portant, le laissant plongé dans un coma profond qui dura sept jours et dont il ne se réveillera jamais.

Ferran Cremades et Tahar Bekri
L’ALBUFERA DE VALENCIA
L’été 1989